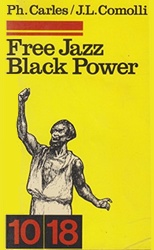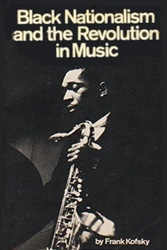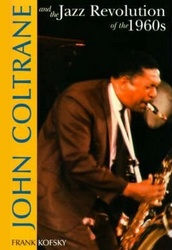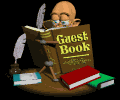Ornette Coleman : Free Jazz - A Collective Improvisation (Atlantic), USA 1961. Ornette Coleman : Free Jazz - A Collective Improvisation (Atlantic), USA 1961.Voici un album qui est souvent et à juste titre considéré comme l'emblème du "free jazz". D'abord, c'est la première fois qu'un album ne contient qu'un seul titre de 37 minutes (séparé en deux parties pour cause de durée limitée des faces de LP mais offert en une seule pièce sur les rééditions en CD) enregistré en une prise unique. Ensuite, il est entièrement improvisé en studio sans aucun guide autre que la succession prédéterminée des solistes et quelques signes faits par le leader à l'un ou l'autre musicien en cours d'enregistrement si bien que personne n'avait une idée du temps que la pièce allait durer. Enfin, l'intitulé prémonitoire de cette improvisation et du disque a donné le nom au mouvement "Free" encore en gestation à l'époque de cet enregistrement (21 décembre 1960). La composition du groupe est aussi totalement inédite puisque ce dernier comprend deux quartets enregistrés chacun sur un des canaux de la stéréo : à gauche, Ornette Coleman lui-même au saxophone alto, Don Cherry à la trompette de poche, Scott LaFaro à la basse et Billy Higgins à la batterie; à droite, le trompettiste Freddie Hubbard, Eric Dolphy à la clarinette basse, le bassiste Charlie Haden et le batteur Ed Blackwell. Les deux sections rythmiques jouent simultanément et soutiennent tout du long les solistes par une solide pulsation. Ces derniers prennent des chorus comme c'est habituellement le cas en jazz mais leurs phrases sont souvent ponctuées et ornementées par les autres membres du groupe, ce qui donne à la musique un côté collectif propre au free jazz. Par ailleurs, les improvisations sont séparées par des interludes en forme de fanfare joués par l'ensemble des souffleurs. En dépit de l'absence totale de thème et de schéma d'accords, cette longue pièce déconcertante reste quand même accessible : les musiciens improvisent dans leur style propre qui reste avant tout du jazz, Freddie Hubbard apparaissant par ailleurs le plus conservateur (ou le moins free) des musiciens crédités ici. On notera aussi deux passionnants duos, l'un entre les deux formidables contrebassistes et l'autre entre les deux batteurs. L'emballage original du LP est tout aussi innovant : il s'agit d'une pochette double avec un petit rectangle découpé en bas à droite qui permet d'apercevoir un fragment du tableau The White Light, reproduit à l'intérieur, du peintre américain de l'expressionnisme abstrait Jackson Pollock. Voici ce que dit Martin Williams dans les notes de pochette originales à propos de cette musique : "Free Jazz n'est pas une pièce dans le sens habituel d'une succession de thèmes et de variations. Les parties écrites sont de brèves introductions pour chaque soliste visant à le présenter et à le propulser musicalement. Les solistes ne font pas de variations. Leur improvisation est la musique elle-même - Le "thème" est ce qu'ils inventent au moment même, dans l'acte, de la création ... L'ensemble par ailleurs ne sort pas nécessairement propre, avec tous les instruments à vent délivrant exactement ensemble les notes assignées. C'est une accrétion de tonalités musicales qui, parfois, peut sembler presque désinvolte." [ Free Jazz (CD & MP3) [ A écouter : Free Jazz (titre complet de 37') ] |
 Sun Ra : The Futuristic Sounds Of Sun Ra (Savoy), 1961. Sun Ra : The Futuristic Sounds Of Sun Ra (Savoy), 1961.Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi l'amateur de jazz n'est que rarement attiré par Sun Ra (qui par ailleurs, si l'on en juge son succès sur internet, fascine quand même un vaste public). D'abord, il y a cet attirail visuel clinquant qui accompagnait le mage sur scène et qui s'étend jusqu'aux pochettes de ses albums dont les dessins font concurrence aux pires posters de films de série Z. Ensuite, il y a ce côté prophète mystificateur qui déclarait être né sur Saturne et qui mettait ses obsessions cosmiques en sons, en paroles et en images. Enfin, il y a cette œuvre musicale insaisissable et cette discographie diffuse et monstrueuse de plus de deux cents disques qui n'arrête pas de gonfler au fur et à mesure que surgissent des inédits et des disques live venant s'intercaler entre les parutions normales. Et pourtant, parmi ces centaines d'heures de musique souvent enregistrée dans des conditions déplorables, s'il y a beaucoup à jeter, il y a aussi quelques chefs d'œuvre qui méritent une écoute attentive car Sun Ra (de son vrai nom Herman Poole Blount né à Birmingham, Alabama, en 1914) était un musicien plein de surprises, un pianiste éclectique, et un pionnier des synthétiseurs, tout en affichant un réel don pour l'arrangement des masses orchestrales. Sa musique peut être répartie en plusieurs périodes chronologiques dont la plus accessible et peut-être la plus intéressante est la première dite "de Chicago" qui s'étend de 1954 à 1961. C'est dans cette ville qu'il constitua son célèbre Arkestra, intégrant des musiciens de premier ordre qui lui resteront fidèles à travers tous ses délires : John Gilmore (sax ténor), Marshall Allen (sax alto et flûte) et Pat Patrick (sax baryton). Les premiers efforts discographiques sont excellents et montrent un big band jouant du jazz mainstream superbement orchestré où percent des percussions envoûtantes et quelques moments plus visionnaires annonçant ce qui viendra ensuite. Les disques les plus intéressants de cette période sont Super-Sonic Jazz (Saturn / Evidence, 1956) et, surtout, Jazz In Silhouette (Saturn / Impulse! / Evidence, 1958) recommandés à tout amateur de jazz orchestral mêlant tradition et modernité.    En 1961, l'Arkestra quitta Chicago et, après un bref détour à Montréal, se relogea à New-York non sans difficulté. Sun Ra entama alors sa deuxième phase musicale avec un disque essentiel qui symbolise son inexorable transition du jazz classique vers une musique free: The Futuristic Sounds Of Sun Ra (1961), le seul de ses albums à avoir été édité sur le label Savoy. On y retrouve encore le bop et les arrangements précis qui caractérisaient la période de Chicago mais ici, l'Arkestra a fondu en perdant quelques uns de ses membres dans le déménagement. Du coup, la musique paraît plus légère tandis que pointent déjà d'autres couleurs qui annoncent de nouvelles directions. Sun Ra y joue exclusivement du piano acoustique de manière fluide et décontractée en donnant l'impression que, dans l'esprit de Duke Ellington, c'est lui qui pousse l'orchestre. Les souffleurs sont en grande forme : John Gilmore joue du saxophone ténor mais aussi de la clarinette basse (écoutez son solo plein de mystère sur l'étrange New Day); Marshall Allen est omniprésent à la flûte; Pat Patrick est fidèle au sax baryton, et le tromboniste Bernard McKinney qui joue aussi de l'euphonium ajoute de riches couleurs harmoniques tout en prenant quelques chorus (What's That?). La section rythmique comprend le bassiste Ronnie Boykins et le batteur Willie Jones en plus de Leah Ananda aux congas. Ce dernier a un rôle essentiel sur certains titres enrichis de tapis percussifs exotiques et ensorcelants (The Beginning, Looking Outward). L'orchestre est complété par le vocaliste Ricky Murray sur China Gate qui évoque déjà les mélopées modales du free jazz. En 1961, l'Arkestra quitta Chicago et, après un bref détour à Montréal, se relogea à New-York non sans difficulté. Sun Ra entama alors sa deuxième phase musicale avec un disque essentiel qui symbolise son inexorable transition du jazz classique vers une musique free: The Futuristic Sounds Of Sun Ra (1961), le seul de ses albums à avoir été édité sur le label Savoy. On y retrouve encore le bop et les arrangements précis qui caractérisaient la période de Chicago mais ici, l'Arkestra a fondu en perdant quelques uns de ses membres dans le déménagement. Du coup, la musique paraît plus légère tandis que pointent déjà d'autres couleurs qui annoncent de nouvelles directions. Sun Ra y joue exclusivement du piano acoustique de manière fluide et décontractée en donnant l'impression que, dans l'esprit de Duke Ellington, c'est lui qui pousse l'orchestre. Les souffleurs sont en grande forme : John Gilmore joue du saxophone ténor mais aussi de la clarinette basse (écoutez son solo plein de mystère sur l'étrange New Day); Marshall Allen est omniprésent à la flûte; Pat Patrick est fidèle au sax baryton, et le tromboniste Bernard McKinney qui joue aussi de l'euphonium ajoute de riches couleurs harmoniques tout en prenant quelques chorus (What's That?). La section rythmique comprend le bassiste Ronnie Boykins et le batteur Willie Jones en plus de Leah Ananda aux congas. Ce dernier a un rôle essentiel sur certains titres enrichis de tapis percussifs exotiques et ensorcelants (The Beginning, Looking Outward). L'orchestre est complété par le vocaliste Ricky Murray sur China Gate qui évoque déjà les mélopées modales du free jazz.Enregistré aux studios Medallion de Newark (NJ) en octobre, l'album fut supervisé par l'un des plus grands professionnels du milieu, Tom Wilson (également auteur des notes de pochette) qui deviendra plus tard célèbre pour ses travaux avec Bob Dylan, les Mothers of Invention, et Soft Machine. En dépit de sa qualité sonore et de son originalité musicale, l'album fut distribué au compte goutte et sombra immédiatement dans une oubliette d'où on ne l'extraira qu'en 1993 pour une première réédition en compact. C'est ce disque-ci qu'il faut écouter en priorité avant de partir à la découverte d'une une phase plus abstraite, plus free et plus enfiévrée où l'on pourra, certes, trouver encore quelques opus majeurs d'un autre genre : The Heliocentric Worlds Of Sun Ra (ESP, 1965) , Atlantis (Evidence, 1969), et Space Is The Place (Impulse!, 1972) entre autre. Sun Ra avait coutume de dire que sa mission sur terre était d'amener les gens à aimer de plus hautes formes musicales. Reparti en mai 1993 en zone interstellaire, il doit sourire aujourd'hui en constatant que sa musique, au départ très secrète, continue à séduire de nouveaux adeptes. [ The Futuristic Sounds of Sun Ra (CD & MP3) [ A écouter : Bassism - China Gate - Tapestry From An Asteroid ] |
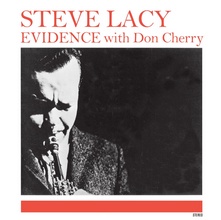 Steve Lacy with Don Cherry : Evidence (New Jazz), USA 1962. Steve Lacy with Don Cherry : Evidence (New Jazz), USA 1962.Avant d'embrasser l'avant-jazz vers le milieu des années 60, le saxophoniste soprano Steve Lacy a joué toutes sortes de styles, du dixieland avec Rex Stewart, Red Allen et Dick Sutton au début des 50's (Dick Sutton Sextet : Progressive Dixieland, Jaguar, 1954) ; du free jazz avec Cecil Taylor de 1955 à 1957 (Cecil Taylor : In Transition, Blue Note, 1956); du jazz orchestral avec Gil Evans en 1957 (Gil Evans : Plus Ten, Prestige, 1957) et avec Miles Davis (Miles Davis : Quiet Nights, Columbia, 1962); du bop au sein du quintet de Thelonious Monk en 1960 ainsi qu'avec son propre quartet de 1961 à 1964 en compagnie du tromboniste Roswell Rudd (School Days, Emanem, 1963). A cette époque, Lacy était totalement subjugué par la musique de Monk et son répertoire était essentiellement centré sur les compositions de l'excentrique pianiste. Cette session enregistrée pour prestige au studio Van Gelder en novembre 1961 ne déroge pas à cette règle puisqu'elle comprend quatre compositions de Monk sur six, les deux dernières ayant été écrites par Duke Ellington / Billy Strayhorn (The Mystery Song et Something To Live For). La surprise réside dans la présence au côté de Lacy du trompettiste Don Cherry alors membre du quartet d'Ornette Coleman, le combo étant complété par le bassiste Carl Brown et le batteur Billy Higgins. Connaissant le penchant naturel des deux solistes pour les formes libres du jazz, on aurait pu s'attendre à des échanges sans modération ni contrôle. Au contraire, les mélodies sont explorées avec beaucoup de clarté et de subtilité par le saxophoniste alors qu'en contrepoint, les solos raffinés du trompettiste sont expurgés de son exubérance habituelle. Il en résulte une musique qui reste cérébrale (interpréter du Monk sans les harmonies du piano est déjà une sacrée gageure en soi) mais qui swingue aussi (écoutez par exemple le quasi hard-bop The Mystery Song). Au final, on se retrouve avec un quartet sans piano similaire à celui d'ornette Coleman mais plus sage, et donc plus accessible … Ce qui n'empêche pas que cette musique constituait à l'époque l'avant-garde du jazz à cause des échanges intenses et acérés entre les musiciens. Et il suffira de se repasser en boucle l'incroyable Who Knows qui démontre comment deux surdoués peuvent absorber complètement l'esprit d'une composition géniale tout en y ajoutant leur propre marque. [ Evidence (CD & MP3) [ A écouter : The Mystery Song - Evidence ] |
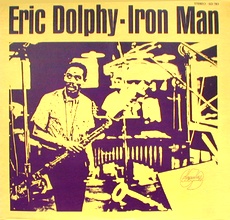 Eric Dolphy : Iron Man (Douglas International), USA 1963. Eric Dolphy : Iron Man (Douglas International), USA 1963.Cet album qui date de 1963 anticipe d'une année Out To Lunch, le chef d'œuvre de Dolphy enregistré pour Blue Note, mais il n'a jamais connu la formidable notoriété de ce dernier. Pourtant, Iron Man ne manque pas de qualités et s'inscrit totalement dans le même esprit que son successeur. Certes, le batteur Tony Wiliams et le trompettiste Freddie Hubbard manquent ici à l'appel mais le Philadelphien J.C. Moses est loin d'être un manchot avec ses baguettes tandis que le virtuose Woody Shaw n'a certainement rien à rendre à Hubbard sur le plan de la facilité et de l'innovation. Par ailleurs, l'orchestre inclut aussi Clifford Jordan au saxophone soprano, Sonny Simmons au sax alto et Prince Lasha à la flûte, ce qui donne lieu à d'intéressants échanges. Quand au contrebassiste, c'est toujours Richard Davis qui occupe le poste avec brio, incitant Dolphy à dialoguer avec lui à plusieurs reprises sur Come Sunday (formidable duo avec Davis à l'archet) et sur Ode To Charlie Parker pour une confrontation anthologique entre flûte et contrebasse. Reste le vibraphoniste Bobby Hutcherson, également présent sur Out To Lunch, qui contribue largement au succès de ces deux albums en tissant derrière les autres musiciens une ambiance flottante et mystérieuse. Les trois compositions de Dolphy, Iron Man, Mandrake et l'ardent Burning Spear, sont certes abstraites et riches en dissonances mais on est loin d'être immergé dans le chaos. Les thèmes bien ajustés sont ancrés dans le be-bop et on n'est jamais tout à fait largué pendant les improvisations. Enfin, le répertoire comprend deux superbes reprises de Duke Ellington (Come Sunday) et de Jaki Byard (Ode To Charlie Parker) qui sont en un sens des ballades mais dans leur genre à eux, sans piano en soutien aux harmonies et dans des arrangements qui sont tout sauf conventionnels. Out To Lunch reste le maître achat mais de peu et ça ne lui donne en aucun cas le droit d'occulter cet Iron Man fort bien produit par le légendaire Alan Douglas, d'autant plus que les disques d'Eric Dolphy, autres que les compilations et bandes live éditées à profusion, ne sont finalement pas si nombreux que ça.
[ Iron Man (CD) [ A écouter : Iron Man - Come Sunday - - Ode To Charlie Parker ] |
 Charles Mingus : The Black Saint And The Sinner Lady (Impulse!), USA 1963. Charles Mingus : The Black Saint And The Sinner Lady (Impulse!), USA 1963.Ce ballet en six mouvements est considéré par beaucoup comme l'œuvre la plus brillante de Charles Mingus et l'une des plus réussies du jazz avant-gardiste. Contrairement aux principes habituels du free dont les enregistrements étaient réalisés sous la forme de grandes créations spontanées captées en une seule prise, The Black Saint And The Sinner Lady fit l'objet de multiples corrections et réenregistrements afin de satisfaire un Mingus perfectionniste et méticuleux qui tient d'ailleurs sa réalisation en très haute estime. Ainsi écrit-il dans les notes de pochette : "Je ne ressens pas le besoin de m'étendre plus avant sur cette musique autrement que de vous exhorter à jeter tous mes disques sauf celui-ci et peut-être un second" (non précisé mais ça pourrait être Mingus Ah Um, son premier album enregistré pour Columbia en 1959). Avec sa formation de onze musiciens, le leader délivre une pièce multi-facettes aux tempos, aux ambiances et aux textures diverses d'où émergent des solistes de premier plan comme Quentin Jackson au trombone, Jerome Richardson au sax baryton et à la flûte et surtout Charlie Mariano qui parvient à faire sortir de son saxophone alto toutes sortes d'émotions qui vont de la joie à une tristesse profonde. A certains moments, l'intensité de cette musique est telle qu'elle se rapproche du free jazz d'un John Coltrane (période Ascension) mais, à d'autres, cette densité se raréfie soudain au profit d'une orchestration d'une précision maniaque qui exclut toute désinvolture dans l'approche. Tout cela renvoie à une vraie composition conceptuelle dans le sens "classique" du terme où l'on entend des orchestrations savantes (qui rappellent parfois Gil Evans) et même des interludes de guitare espagnole interprétés par Jay Berliner. Pour cette raison, cette œuvre est à l'opposé des musiques qu'on passe en arrière plan pour agrémenter une ambiance : il faut s'y donner à fond comme on le fait pour tout œuvre d'art. Sans être exagérément abrasive, cette composition tire le jazz dans une nouvelle direction qui ne sera guère exploitée par d'autres musiciens. En plus, elle véhicule un message à propos du choc des races et de leurs conséquences à travers l'histoire mais, là, même en connaissant les idées de l'auteur dont j'ai lu l'autobiographie corrosive, j'ai du mal à m'y retrouver et il faut bien avouer que les notes de pochettes, aussi bien celles de Mingus que celles écrites pas son psychologue, n'aident pas vraiment. Mais qu'importe, la musique éclate avec force : c'est excentrique, bouillonnant, ambitieux, compliqué, violent et tendre à la fois. Ceci dit, j’avoue avoir un problème avec cette pièce non pas à cause de son côté avant-gardiste mais plutôt en raison de sa discontinuité, son approche hybride qui exige qu’elle ne soit pas seulement appréciée par rapport au jazz mais aussi sur la base d’autres valeurs de référence et, en particulier, celles de la musique classique occidentale (après tout, The Black Saint est à l’origine un ballet). Et sur ce plan là, quelques motifs mélodiques classicisants semblent avoir été ajoutés comme dans un collage, comme si l’ambitieux Mingus voulait à tout prix qu’ils soient inclus dans une composition de cette nature. Certains de ces motifs donnent l’impression d’avoir été entendus ailleurs. Et plusieurs réapparaissent à de multiples reprises sans qu’on ne sache trop pourquoi. Le tout constitue une architecture un peu labyrinthique qui impressionne surtout par la qualité obsessionnelle des arrangements ainsi que par le jeu et l'engagement collectifs des musiciens. Qu’on ne se méprenne pas, l’œuvre reste grandiose et unique dans l’histoire du jazz dont elle transcende les limites de l’époque et où, ailleurs que chez Mingus lui-même, elle n’a guère donné de descendance. Simplement, ne suivez pas trop vite le conseil de Mingus et ne jetez pas ses autres albums. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore sa musique, mon conseil serait de commencer d’abord par les disques Mingus Ah Hum, Mingus 5x, ou même Tijuana Moods avant de passer prudemment à celui-ci afin de le juger par soi-même en bonne connaissance de cause. [ The Black Saint And The Sinner Lady (CD & MP3) [ A écouter : The Black Saint And The Sinner Lady (Full Album) ] |
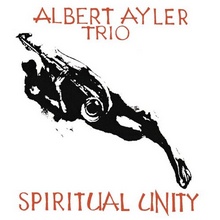 Albert Ayler : Spiritual Unity (ESP 1002), 1964. Albert Ayler : Spiritual Unity (ESP 1002), 1964.Cet enregistrement a été effectué à New York le 10 juillet 1964, juste avant le départ d’Albert Ayler pour l’Europe en septembre. Spiritual Unity sera son premier disque édité par le nouveau label culte de Bernard Stollman, ESP, dont certains pensent que le nom est un sigle pour Extra Sensory Perception. Ayler est alors à la tête d’un trio composé du contrebassiste Gary Peacock et du batteur Sunny Murray, deux musiciens qui semblent avoir été spirituellement en phase avec le leader. Après avoir lâché le thème naïf de Ghosts, Ayler s’enfonce illico dans l’abstraction en balançant par la fenêtre tout ce qui peut se rapporter à la mélodie, à l’harmonie, aux barres de mesure et même aux techniques orthodoxes de son saxophone qui a une sonorité rauque et torturée. Murray accompagne avec une fixation sur ses cymbales et Peacock, dont je n’imaginais pas qu’il puisse se mettre ainsi au diapason d’une telle déstructuration, prend un solo de contrebasse totalement désarticulé. Si bien que quand le thème revient à la fin du morceau, il procure par comparaison avec ce qui précède un sentiment de sérénité absolument jouissif. The Wizard est encore plus abrasif car le thème y est quasiment inexistant. Les sons stridents et chaotiques éructés par Ayler avec un souffle tellurique renvoient à quelque malédiction inintelligible que ses comparses ne font absolument rien pour endiguer. Sur l’autre face du LP, Spirits est ce qu’on pourrait appeler le versant lyrique d’Albert Ayler. Bien épaulé par le jeu de basse télépathique de Peacock, son chant est cette fois constitué de plaintes effrayantes qui évoquent à merveille le monde des esprits auquel le titre fait référence. La dernière plage de ce disque très court est une seconde variation sur le thème de Ghosts qui deviendra par la suite son morceau fétiche. Cette cacophonie agressive, qui constitue une expression aussi radicale qu' unique, s’oppose à toutes les normes esthétiques de la musique occidentale à l’aune de laquelle elle ne saurait être jugée. Même les thèmes mélodiques, empruntés à des fanfares ou à des rengaines folkloriques, sont volontairement réduits à une caricature. Cette opposition aux lois de la musique "sérieuse" et réglementée, qui existait déjà à l’origine du jazz, est ici exacerbée à l’extrême jusqu’ à devenir une agression permanente et obsessionnelle qui laisse imaginer un esprit rebelle, révolutionnaire, voire violent et conflictuel. Cette prise de position lui vaudra une incompréhension, voire une aliénation, quasi unanime de la part des critiques et des musiciens de son temps. Paradoxalement, cette image qu’il donnait de lui-même par sa musique sauvage était en contradiction totale avec ses messages de paix, d'amour et de spiritualité qu’Ayler répandait autour de lui et qui imprègnent les intitulés de ses disques (Spiritual Unity, Vibrations, Spirits Rejoice, Love Cry) et de ses morceaux (Spiritual Bells, Angels, Prophet, Divine Peacemaker, All Love, Spiritual Reunion …). On l’aura compris : des notes et de la musique, il n’en est pas question ici. Spiritual Unity est, comme le disait Ayler lui-même, une affaire de perception. Cet album qui a marqué profondément les esprits de l'époque est une brèche, une déchirure, une fracture dans l’histoire du jazz en tant qu’expression du peuple afro-américain et, à ce titre, il faut l'avoir écouté au moins une fois pour comprendre ce qui est venu après. Ceci explique pourquoi une page consacrée au free qui omettrait Albert Ayler n'aurait aucun sens. Bon, comme disent les scientifiques, ça c'est fait ! [ Spiritual Unity [ A écouter : Ghosts - First Variation - The Wizard - Spirits - Ghosts Second Variation ] |
 Archie Shepp : Four For Trane (Impulse!), 1964. Archie Shepp : Four For Trane (Impulse!), 1964.En août 1964, Archie Shepp est enfin arrivé à ses fins: enregistrer un premier disque en leader pour le prestigieux label Impulse!. Dans les studios d'Englewood Cliffs, Rudy Van Gelder est à la console mais le patron Bob Thiele n'est guère enthousiaste. il a exigé que Shepp ne joue que des reprises de Coltrane mais il sait que Shepp a une réputation de musiciens radical, qu'il n'a pas le bagage technique pour reproduire les harmonies compliquées de Coltrane et que s'il est là aujourd'hui, c'est à cause de l'insistance de Coltrane qui a lui a forcé la main. Mais Shepp s'est préparé à l'avance et il a réuni pour cette session des musiciens de haut vol: Roswell Rudd au trombone qui a travaillé les arrangements avec beaucoup de lucidité, le Danois John Tchicai (New York Contemporary Five) au saxophone alto qu'on n'entend soloter que sur le dernier titre, Alan Shorter, le frère aîné anticonformiste de Wayne Shorter, à la trompette et une rythmique de feu composée du contrebassiste Reggie Workman (Jazz Messengers, John Coltrane) et du batteur Charles Moffett (Ornette Coleman). Quand l'enregistrement démarre, il apparaît clairement que Shepp a une autre ligne directrice que de tenter de reproduire du Coltrane. Sa musique jaillit spontanément comme celle de Mingus et elle est connectée directement au blues profond dont le saxophoniste est un ardent interprète. Les arrangements de Rudd, en particulier sur Naima, sont d'une étonnante fraîcheur et la rythmique est en apesanteur. Quant à Shepp, il explore le registre medium de son instrument avec une force inouïe, faisant sourdre des sons primaux et naturels qui renvoient aux profonds et sombres mystères d'une Afrique ancestrale. En entendant cette musique, Bob Thiele se détend et appelle Coltrane qui viendra au studio pour écouter les bandes. Sur la célèbre photo de la pochette, prise par Chuck Stewart, on voit Coltrane debout près de l'escalier du studio écoutant les bandes avec application au côté d'un Archie Shepp assis, détendu et apparemment satisfait. Seul le dernier morceau, qui est une composition de Shepp appelée Rufus, déplaît à Bob Thiele. Elle fait référence à un lynchage et paraît à l'écoute plus radicale. Mais elle séduit Coltrane et, sur son conseil, Thiele finira par céder et l'inclure dans le répertoire. Quand le disque sort, son expressivité, son exubérance et son originalité convainquent les amateurs de free jazz qui y voient l'une des œuvres phares du mouvement. En prolongeant l'œuvre de Coltrane, Shepp a gagné son pari, la reconnaissance de ses pairs, ainsi que son ticket d'entrée sur le label orange et noir. Et plus jamais, on ne lui imposera quoi que ce soit à propos de sa musique avant d'entrer dans un studio d'enregistrement. [ Four For Trane (CD & MP3) [ A écouter : Naima - Syeeda's Song Flute ] |
 John Coltrane : OM (Impulse!), Octobre 1965. John Coltrane : OM (Impulse!), Octobre 1965.De tous les albums free de john Coltrane, OM est le pire (avec le dernier concert au Olatungi avant sa mort). Rien ici ne subsiste sinon des cris, des grognements, des grincements, des hurlements éructés des saxophones furieux de Coltrane et de Pharoah Sanders. Non seulement l'écoute est trop éprouvante pour en tirer le plus infime plaisir mais en plus, le concept même est biaisé. L'oeuvre est en effet intitulée OM (ou AUM), la syllabe sanskrite considérée comme la vibration primitive divine de l'Univers, que l'on utilise comme préfixe ou suffixe aux mantras dans un but de méditation. C'est son symbole en devanagari qui figure sur le médaillon de la pochette du label Impulse! (qui pour une foi n'est pas consacrée à un portrait du saxophoniste) et on entend, perdus dans la tourmente sonore, quelques extraits du livre sacré hindou, la Bhagavad Gita, ainsi que du Livre des Morts tibétain. Or, Coltrane n'en a retenu qu'une signification, celle du son primal regorgeant de puissance à partir duquel se structura l'univers entier. Alors qu'on aurait pu s'attendre par analogie à une structuration progressive de la forme musicale, on est ici plongé de manière quasi permanente dans un chaos complet qui n'évoluera pas sur les 29 minutes que dure l'unique morceau du compact (séparé en deux parties sur le LP original). L'énergie dégagée, aléatoire et immense, noie les qualités des musiciens talentueux qui n'ont guère la liberté de s'exprimer autrement que dans l'assaut collectif mais, surtout, c'est une énergie sombre et violente où ne perce ni lumière ni espoir. Lors de sa sortie posthume en 1968, j'ai eu l'impression que Coltrane était arrivé au bout de sa quête, à la fin du jazz. Aujourd'hui, ce sont les mots terribles écrits par Jacques Reda à propos d'Albert Ayler qui me reviennent en mémoire : ce contre quoi il se heurtait n'était donc pas une limite infranchissable, mais l'espace inerte et sans fin que peut être aussi la fin, où n'avancent plus que des fantômes, qui n'est plus peuplé que de démons, de sorcières, d'esprits, de vibrations. Il les a tous poussés devant lui dans un emportement de panique... Sauf une fois, juste avant d'écrire cette chronique, je n'ai jamais réécouté ce disque angoissant qui est rangé comme un grimoire maudit dans le coin le plus obscur de ma discothèque et qui n'en ressortira probablement plus jamais. [ Om (CD & MP3) [ A écouter : OM (Part One) ] |
 Cecil Taylor Unit : Unit Structures (Blue Note), 1966. Cecil Taylor Unit : Unit Structures (Blue Note), 1966.Les années 60 furent une période difficile pour Cecil Taylor. Considéré par beaucoup, malgré le free jazz en vogue, comme un pianiste de l'extrême, son jeu percussif violent et atonal ne faisait guère d'adeptes. Il parvint toutefois à enregistrer deux disques pour Blue Note qui, après leur sortie, n'arrangèrent pas les choses, certains critiques sans imagination allant même jusqu'à écrire que le piano sur cet album aurait tout aussi bien pu être joué au hasard. Et le fait est que l'absence totale de mélodie et la déstructuration musicale sont aussi provocantes que perturbantes. Certes les prouesses techniques des musiciens du septet, en particulier celles des trois souffleurs Eddie Gale (tp), Jimmy Lyons (as), et Ken McIntyre (as, hautbois et clarinette basse), sont impressionnantes même si on se demande s'ils savent vraiment où ils vont alors que le leader joue à l'arrière et de manière frénétique des clusters de notes sans être apparemment disposé à fournir une direction compositionnelle. On dit pourtant que le groupe aurait longtemps répété avant d'entrer dans le studio, ce qui démentirait une musique collective totalement spontanée et donc "free" au détriment de compositions abrasives mais sous contrôle plutôt dans l'esprit de la musique européenne avant-gardiste. Toutefois, si sens il y a, il n'est pas donné à tout le monde de le saisir. Comme beaucoup de musique atonale, le plus simple est alors d'écouter cet album au second degré en oubliant volontairement de se fixer sur la rythmique intense et disjointe (qui inclut un batteur et deux contrebassistes), les cacophonies du piano et les cris des souffleurs pour laisser les sons couler dans leur glorieuse abstraction. De façon étonnante, des images peuvent alors surgir du chaos en relation avec votre propre univers antérieur. Les notes de pochette, écrites par Taylor, sont à lire absolument en ce qu'elles apportent, sans rien clarifier, leur part d'intellectualisation poétique et ésotérique à une œuvre qui n'a aucun équivalent dans l'histoire du jazz. Quant au design pop'art conçu par Reid Miles, c'est assurément l'un des plus réussis du label. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir un Cecil Taylor toujours novateur mais beaucoup moins radical, mieux vaut acquérir l'album Looking Ahead! (Contemporary) qui date de 1958. Taylor y joue déjà du piano d'une façon très personnelle et plante les graines de ce qui viendra plus tard mais ses compositions swinguent encore dans un contexte bop qui les rend abordables. A noter la présence dans le quartet du vibraphoniste newyorkais Earl Griffith qui ne laissera aucune trace dans l'histoire à part ce disque mais dont le jeu classique complémente bien celui de Taylor tout en apportant un vent de fraîcheur à la session. [ Unit Structures (CD & MP3) [ A écouter : Steps ] |
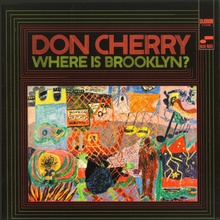 Don Cherry : Where Is Brooklyn? (Blue Note), 1966. Don Cherry : Where Is Brooklyn? (Blue Note), 1966.Don Cherry enregistra trois albums en moins d'un an pour le label Blue Note : Complete Communion (24 décembre 1965), Symphony For Improvisers (19 septembre 1966) et celui-ci (11 novembre 1966) qui, contrairement aux deux premiers, resta deux ans et demi dans l'ombre avant d'être finalement édité en juin 1969. C'est aussi le dernier disque pour Blue Note, Cherry étant reparti peu de temps après l'enregistrement pour l'Europe avec l'intention de voyager à travers le monde et d'étendre son univers musical à d'autres cultures. En quartet avec le saxophoniste ténor Pharoah Sanders, le contrebassiste Henry Grimes et le batteur Ed Blackwell, Cherry revient ici à une conception d'album plus traditionnelle. Il abandonne en effet les longues compositions à tiroirs qui, sur les deux disques précédents, occupaient chacune toute une face de LP au profit de titres plus courts bien séparés par des intervalles de silence. Ceci dit, quand il y en a, les thèmes sont réduits au strict minimum pour laisser rapidement la place à des improvisations débridées pleines d'énergie et de passion délivrées sur des rythmiques éruptives. Longtemps membre du groupe d'Ornette Coleman, Blackwell sait comme déchaîner la foudre sur ses fûts tandis que Grimes, qui a joué avec Albert Ayler, est le bassiste idéal pour cette session. Agé de 26 ans, Pharoah Sanders, plongé à l'époque dans la tourmente coltranienne, affiche au ténor ce son énorme qui le caractérise et délivre des solos agressifs qui débordent invariablement sur des cris libertaires aussi expressionnistes que chaotiques. En comparaison, le cornettiste apparaît plus structuré et rend la musique (relativement) plus facile à suivre. Ceux qui recherchent du swing et des belles mélodies peuvent passer leur chemin mais les amateurs de duels ouverts et explosifs trouveront ici une musique nerveuse, dense, tourmentée et follement libre qui compte parmi ce que l'avant-garde a produit de mieux. [ Where Is Brooklyn? (CD & MP3) [ A écouter : There Is the Bomb ] |
 Pharoah Sanders ; Tauhid (Impulse!), 1967. Pharoah Sanders ; Tauhid (Impulse!), 1967.Quand Pharoah (une déformation de son vrai prénom Ferrell) Sanders arrive chez Impulse!, il a déjà un disque sous son nom paru sur le label ESP (Pharoah's First, 1964) mais ce dernier, enregistré dans un contexte trop conventionnel, ne rend pas justice à l'expressivité du saxophoniste qui paraît absent. Par contre, il a joué avec Coltrane et est crédité à ses côtés sur quelques albums dont Live In Seattle, OM, Kulu Se Mama et Live At The Village Vanguard Again. Des œuvres à l'époque fort controversées à cause du total abandon des formes traditionnelles de jazz mais qui mirent en exergue la puissance des souffleurs. Upper Egypt And Lower Egypt, premier titre de Tauhid, est l'une des compositions phares de Sanders dont les idées, qui ne sont pas encore devenues des clichés, s'épanouissent au milieu de sidemen en phase avec ses conceptions comme Sonny Sharrock (guitare), Dave Burrell (piano) et Henry Grimes (basse). Mais surtout, Sanders y démontre son sens du lyrisme et de la mise en scène installant patiemment une atmosphère mystique qui va crescendo au fur et à mesure qu'il descend le Nil de la Haute vers la Basse-Egypte. Sanders laisse la parole à ses complices et se contente d'intervenir au piccolo avant de passer enfin au ténor et de mettre le feu pendant les dernières minutes. Le reste est tout aussi gratifiant avec un Japan exotique en forme de souvenir de voyage (Sanders y avait joué récemment avec Coltrane) tandis que Aum, interprété à l'alto, et Venus déchaînent les enfers. Enfin, après la tempête, le calme revient in extremis avec un Capricorn Rising pacifique comme une mer étale (à noter que les trois derniers titres sont enchaînés comme dans un medley). Pharoah Sanders n'aura finalement donné que des chefs d'œuvre au label Impulse! avant que les moguls d'ABC-Paramount ne le mettent à la porte en 1973 pour restructuration économique. Ornementé d'une superbe photographie de Charles Stewart, bien enregistré par Rudy Van Gelder aux Studios d'Englewood Cliffs et produit par Bob Thiele, Tauhid était le premier d'entre eux. [ Tauhid [Remastered] [ A écouter : Upper Egypt & Lower Egypt (Part 1) - Upper Egypt & Lower Egypt (Part 2) ] |
 Charlie Haden Liberation Music Orchestra (Impulse!), 1969. Charlie Haden Liberation Music Orchestra (Impulse!), 1969.Connu pour apporter son soutien à la lutte contre toute dictature, le contrebassiste Charlie Haden (qui fit un séjour dans les prisons portugaises du Président Antonio Salazar) réunit en 1969 les grands noms du free jazz de l'époque pour enregistrer l'un des plus beaux hommages à la liberté des peuples. Gato Barbieri, Dewey Redman, Don Cherry, Mike Mantler, Roswell Rudd, Howard Johnson, Paul Motion, Carla Bley et quelques autres revisitent ensemble des chants républicains de la guerre civile espagnole, l'hymne We Shall Overcome et des compositions de Bley, Ornette Coleman et Haden lui-même. La musique, savamment orchestrée par une Carla Bley qui a en elle le sens des textures, est emportée par une force irrésistible qui la transcende. La beauté naît soudain de ces mélodies latines à l'âpreté si mélancolique et survit jusque dans les poussées collectives, témoignages exacerbés d'une frénésie de liberté. Voici ce qu'en dit Charlie Haden lui-même : la musique de cet album est dédiée à la création d'un monde meilleur ; un monde sans guerre ni crime, sans racisme, sans pauvreté ni exploitation ; un monde où les hommes de tous les gouvernements réalisent l'importance primordiale de la vie et s'efforcent de la protéger plutôt que de la détruire. Espérons en une nouvelle société éclairée et sage au sein de laquelle la pensée créative deviendra la force dominante de l'humanité. [ Liberation Music Orchestra (CD & MP3) [ A écouter : El Quinto Regimiento - Los Cuatro Generales - Viva la Quince Brigada ] |
 Jan Garbarek : Afric Pepperbird (ECM), Norvège 1970. Jan Garbarek : Afric Pepperbird (ECM), Norvège 1970.Quoi ? Jan Garbarek sur une page consacrée au free-jazz ? Et bien oui. Avant de devenir l'interprète lyrique d'un jazz "new age" éthéré emblématique de l'esthétique du label ECM, le Norvégien a enregistré quelques disques beaucoup plus turbulents où percent l'influence d'Albert Ayler, de Pharoah Sanders et du free jazz en général. Le frénétique Beast Of Kommodo est ainsi une plongée dans une nature sauvage où résonnent les cris des dragons. Le son du saxophone est plein, rauque, et le phrasé terriblement expressif. Au dessous, la trame rythmique tissée par le batteur Jon Christensen et le bassiste Arild Andersen est envoûtante comme une danse tribale. Quant au guitariste Terje Rypdal, il ajoute avec conviction des bruits qui amplifient l'ambiance et le dépaysement avant de prendre un de ces solos torturés dont il a le secret. Entre-temps, le leader est passé à la flûte et termine ce voyage "into the wild" par quelques arabesques apaisées. La plage éponyme est aussi un grand moment d'aventure dont le groove évoque cette fois un périple au cœur du désert avec des notes rémanentes qui flottent dans l'air comme des parfums d'Orient. Citons encore Blow Away Zone dont le titre explicite va comme un gant aux solos de guitare et de saxophone totalement éclatés et le court Mah-Jong avec son solo de contrebasse digne d'un Dave Holland. Première rencontre entre Garbarek et Manfred Eicher, la session a fait l'objet d'un enregistrement et d'une production hyper-soignés: le son est clair, le mixage magique et tous les instruments sont parfaitement audibles, surtout la batterie de Christensen qui est littéralement fragmentée en ses diverses composantes (ah! Ce jeu sur les cymbales!). Cette septième production ECM (elle porte le numéro 1007) a fait forte impression en Europe et c'est grâce à sa qualité que Manfred Eicher, patron du label encore à la recherche d'une identité, parviendra à attirer Keith Jarrett dans ses filets. Les quatre musiciens de cette session deviendront tous des stars du jazz européen. Quant à la musique d'Afric Pepperbird, elle compte non seulement parmi les plus grandes réalisations spontanées de Garbarek qui ne retrouvera plus par la suite une inspiration aussi riche et mordante qu'ici, mais c'est aussi l'une des émanations du free jazz parmi les plus réussies et les plus influentes du début des années 70. [ Afric Pepperbird (CD & MP3) [ A écouter : Beast Of Kommodo ] |
 David Murray : Flowers For Albert (India Navigation Company) 1976. David Murray : Flowers For Albert (India Navigation Company) 1976.Au milieu des années 70, des artistes originaires de différentes villes des Etats-Unis se sont concentrés dans d'anciens espaces industriels désaffectés situés notamment dans le quartier de SoHo et dans le Lower East Side à New York. Dans ces lieux qui servaient à la fois d'habitation et d'espace de répétition, de rencontre et d'échange, des musiciens comme David Murray, Sam Rivers, Rashied Ali, Muhal Richard Abrams, Anthony Braxton, Henry Threadgill et le trio Air, Chico Freeman et d'autres revisitèrent le free jazz de leurs aînés dans le but de le désenclaver et de lui assurer un futur. C'était aussi, pour les musiciens, la possibilité de donner des concerts en dehors du circuit traditionnel des clubs peu ouverts à ce genre de musique expérimentale. Parmi les lofts les plus célèbres, on retiendra surtout le RivBea de Béatrice et Sam Rivers, l'Artist House d'Ornette Coleman, et Environ du batteur et journaliste Stanley Crouch. Ce phénomène, qu'on désignera sous le nom de la "génération des lofts" finira par disparaître au fur et à mesure que les productions trouveront leur chemin hors des lofts mais il est resté dans l'histoire comme un mouvement socioculturel productif, aussi original que passionnant. Quant aux enregistrements datant de cette époque, ils ont bien sûr été gravés sur de petits labels indépendants comme India Navigation Company, fondé par Bob Cummins, qui devint très vite spécialisé dans la production des musiciens de la "loft generation". Arrivé à New York en 1975, David Murray s'est très vite mêlé aux musiciens des lofts en s'associant à divers évènements musicaux. Son premier album édité sous son nom, Flowers For Albert, fut enregistré lors d'un concert donné le 26 juin 1976 dans un loft connu sous le nom de Ladies' Fort à New York en compagnie du trompettiste Olu Dara, du bassiste Fred Hopkins et du batteur Phillip Wilson. Agé de 21 ans, Murray écrivait déjà des thèmes mémorables tandis qu'il afficha illico cette énergie exceptionnelle qui le caractérisera par la suite dans tous ses disques. Le titre éponyme sera réenregistré à diverses reprises par Murray mais sans vraiment rien ajouter à la spontanéité et à la dynamique de cette première version. Il est évident d'après son intitulé que cette pièce est un hommage rendu à Albert Ayler, dont le batteur Sunny Murray lui a raconté la mort mystérieuse dans le port de New York en novembre 1970, mais le jeu de David Murray, à part le fait qu'il pousse lui-aussi l'utilisation de son sax ténor au bout de ses capacités, est plus mélodique et structuré, donc plus ancré dans la tradition que celui d'Ayler dont l'influence musicale sur Murray ne semble pas avoir été significative. Certes, les passages free sont bien présents mais ils sont amenés avec discernement dans une structure qui prend son temps pour n'éclater qu'à certaines occasions, ce qui, en fin de compte, rend la musique beaucoup plus accessible. Les autres pièces sont également passionnantes, en particulier Joanne's Green Satin Dress qui, après l'exposé du thème par les deux souffleurs, inclut de chouettes interventions de Dara et du leader ainsi que Ballad For A Decomposed Beauty sur lequel Murray dialogue avec la contrebasse jouée à l'archet. La version en double CD (Flowers For Albert : The Complete Concert) inclut les morceaux figurant sur le double LP initial plus trois titres inédits en quartet issus du même concert : Barbara And Crenshaw Follies et The Hill dont Murray donnera d'autres versions plus tard (notamment en trio sur l'album The Hill de 1986) et After All This qui, lui à ma connaissance, n'a jamais été rejoué. Ce formidable album est doublement historique, d'une part parce qu'il documente le jazz novateur qui était conçu dans les lofts des années 70 et, d'autre part, parce qu'il révèle tout le potentiel d'un jeune saxophoniste vraiment singulier par sa technique d'harmonisation originale, par le choix audacieux de ses notes, et par sa sonorité furieuse et sombre agrémentée parfois d'un profond vibrato à la Coleman Hawkins. [ Flowers For Albert - The Complete Concert [ A écouter : Flowers for Albert (full album) ] |
 The Art Ensemble of Chicago : Urban Bushmen (ECM 2CD) 1982. The Art Ensemble of Chicago : Urban Bushmen (ECM 2CD) 1982.Enregistré en mai 1980 à Munich, ce concert intégral proposé à l'époque sur un double LP donne une idée de la singularité et des possibilités de l'Art Ensemble of Chicago. Du Quartier Français de La Nouvelle Orléans à la savane africaine, des grandes cités urbaines aux danses des Caraïbes, du réveil militaire en trompette aux polyphonies primitives, des cris, clochettes, gongs et sifflets aux incantations filtrées par un mégaphone, ce quintet de multi-intrumentistes surdoués donne une autre signification au free jazz qui devient la somme de toutes les musiques, l'alpha et l'oméga de toutes les cultures ayant surgi du continent africain pour finalement essaimer à travers le monde. Pour étrange et hétérogène qu'elle soit, cette musique est aussi abordable, à la fois mystique, exotique, mystérieuse, archaïque, moderne ou même parfois faussement minimaliste quand elle se réduit à un simple bourdon (Ancestral Meditation). Mais elle séduit aussi par des thèmes d'une étonnante fraîcheur (le quasi hard bop Odwalla et la ballade nostalgique New York Is Full of Lonely People qui est l'une de des plus belles compositions de Lester Bowie). La diversité des idées et l'indescriptible interaction entre ces musiciens aux allures de sorciers bariolés, qui à eux tous ne jouent pas moins de soixante-dix instruments sur scène, est stupéfiante. Véritable happening tribal, ce concert est à écouter d'une traite tant les improvisations et les structures sonores s'enchaînent avec grâce comme dans une unique et immense suite musicale. Et quand le concert s'achève sur quelques applaudissements polis, on regrette seulement de ne pas avoir été dans le public de l'Amerika Haus de Munich ce soir là. Urban Bushmen a beau être l'une des productions parmi les plus anachroniques du label ECM, c'est aussi l'une des plus captivantes. [ Urban Bushmen (2CD & MP3) [ A écouter : Urban Magic ] |